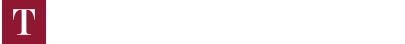L’esclavage dans l’oeil des salons genevois
Dans la Genève du XVIIIe siècle, écrivains abolitionnistes et acteurs de la traite étaient souvent membres des mêmes milieux. L’historien Bouda Etemad restitue la façon dont les idées, les justifications et les scrupules circulaient
Sylvie Arsever
Auteur de plusieurs études sur l’implication de Suisses dans l’esclavage et la colonisation, Bouda Etemad, professeur honoraire d’histoire aux universités de Genève et Lausanne, a buté sur la pauvreté des sources. On en sait peu sur le volume exact de cette implication, sinon qu’elle est marginale dans le tableau d’ensemble et due exclusivement à des acteurs privés. Et on en sait encore moins sur les hommes concernés, leurs idées, leurs justifications, leurs éventuels scrupules. Son dernier livre, De Rousseau à Dunant, se veut une réponse à cette difficulté. Les écrivains plus ou moins célèbres et plus ou moins doués qu’il y évoque ont tous écrit sur ces questions. Ils étaient souvent membres des mêmes milieux que les acteurs de la traite et de l’exploitation coloniale. Et parfois leurs amis.
Y a-t-il au XVIIIe siècle un regard proprement genevois sur la traite et l’esclavage?
Genève sert surtout de relais à des idées qui viennent d’ailleurs. C’est une ville ouverte sur l’extérieur, dont les lettrés profitent de réseaux internationaux et font pleinement partie du milieu intellectuel européen. Le salon tenu par Germaine de Staël à Coppet est emblématique à cet égard: on y vient de toute l’Europe. Et on y croise aussi bien des planteurs esclavagistes que des abolitionnistes comme Mme de Staël elle-même, ou comme Sismondi, qui est l’un des seuls à soutenir que les propriétaires d’esclaves libérés n’ont droit à aucun dédommagement, car la possession d’un autre humain n’est qu’un vol.
En somme, la remise en cause de l’esclavage est une idée comme une autre, qu’on peut discuter avec des négriers, entre gens de bonne compagnie?
C’est en tout cas une idée hors sol, qui ne suscite pas, contrairement à ce qui se passera par la suite, de fronts bien nets. Même Rousseau, qui parle peu de l’esclavage mais le condamne de la façon la plus radicale, a pour protecteur un négociant neuchâtelois, Pierre-Alexandre DuPeyrou, qui a fait fortune notamment en exploitant une plantation esclavagiste au Surinam. Ce dernier est un lecteur des philosophes et finance une édition complète des oeuvres de Rousseau. Dans le bel hôtel qu’il a fait construire à Neuchâtel, on rencontre aussi Etienne Clavière, un fils de réfugié huguenot, et le comte de Mirabeau, futur révolutionnaire, qui fonderont ensemble la Société des amis des Noirs en 1788.
Quelles sont alors les raisons de s’opposer à l’esclavage?
Elles sont, je pense, avant tout morales. Une morale qui semble spécifique au milieu protestant, lequel porte au début l’idée abolitionniste. A Genève, elle apparaît ainsi dès 1771 sous la plume d’un précurseur aujourd’hui oublié, Jean-François Butini. Mais elle est aussi défendue avec des arguments économiques: non seulement l’esclavage souille ceux qui le pratiquent, mais en plus il leur fait perdre de l’argent.
Et c’est vrai?
Non. Les études récentes démontrent que la traite négrière a rapporté, en moyenne, plus que d’autres activités commerciales. L’agriculture de plantation esclavagiste était elle aussi relativement rentable. Mais à l’époque, on ne pouvait sans doute pas le mesurer. Tout au plus faisait-on valoir qu’un traitement plus humain de la main-d’oeuvre servile améliorerait leur rendement.
Traitement qui devait être appliqué dans le cadre colonial…
C’est une des choses qui m’a étonné lorsque j’ai commencé cette étude. Tous les Genevois qui se sont engagés contre l’exploitation esclavagiste ou les abus de la colonisation restent favorables en principe à cette dernière. Même Clavière, même René Claparède – qui s’engage au début du XXe siècle dans la défense des peuples spoliés. Le seul à faire exception est Rousseau, dont l’anticolonialisme ne dépasse cependant pas le niveau des principes. Pour les autres, l’exploitation coloniale est justifiée si elle est modérée, bienveillante et permet aux peuples soumis de se «relever». Ce dernier argument sert beaucoup. Il est notamment utilisé par Gustave Moynier pour justifier l’aventure coloniale très brutale du roi des Belges Léopold II au Congo.
Car bien sûr les peuples extra-européens sont moins civilisés?
C’est une conception que les auteurs étudiés partagent largement. L’Europe représente un modèle de réussite exceptionnel et il paraît à tout le monde que c’est le seul. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il va de soi qu’il existe entre l’Europe et le reste du monde un écart civilisationnel, induit par la géographie et l’histoire. Mais, selon le credo universaliste, l’Europe «avancée» pourrait faire en sorte non seulement que l’écart se réduise, mais également que les niveaux s’égalisent.
Cela change ensuite…
Vers la fin du XIXe siècle, on voit apparaître l’idée que l’écart est irréductible. Que finalement, il ne sera pas comblé, que les peuples différents ne peuvent être gouvernés que par des règles différentes. Parmi les Genevois, c’est notamment l’avis de Léopold de Saussure, qui critique âprement le modèle soi-disant assimilationniste qui préside à la colonisation française, notamment en Algérie. Les «races» humaines, pour lui, n’ont cessé de diverger depuis le début, de sorte qu’une grenouille (maghrébine) ne saurait devenir un boeuf (européen), quoi qu’elle fasse.
En somme, si nous rencontrions aujourd’hui l’un des hommes dont vous avez étudié les idées sur l’esclavage et la colonisation, nous penserions, dans le meilleur des cas, que c’est un vilain raciste?
Aujourd’hui, leurs idées ont été reprises, développées ou corrigées par d’autres; d’autres développements sont intervenus. Nous bénéficions de cette connaissance et nous jetons sur les choses un regard nouveau. Cela nous a amenés à prendre conscience différemment des violences de la traite et de la colonisation. Ces questions sont désormais présentes dans le débat public et c’est une bonne chose: nous ne pouvons plus dire, comme on le disait il y a encore quelque temps en Suisse, «cela ne nous concerne pas».
Mais comme historien, il me semble que je n’ai pas à juger le passé avec mes valeurs d’aujourd’hui. Je suis plus utile en m’efforçant de replacer les actes et les paroles de l’époque dans leur contexte, ce qui permet de mieux les comprendre. Et de ne pas demander à des hommes qui ont vécu il y a deux siècles de dépasser ce qui était alors leur horizon. ■
Livres
fr-ch
2023-02-25T08:00:00.0000000Z
2023-02-25T08:00:00.0000000Z
https://letemps.pressreader.com/article/282226604916871
Le Temps SA