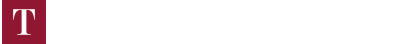Bande dessinée
En noir et blanc, Harold Schechter et Eric Powell analysent le parcours criminel d’Ed Gein, parangon des tueurs en série
Le retentissement de l’affaire est énorme, relayé par les médias de tout le pays comme un feuilleton morbide. Alors que la guerre froide a commencé depuis une dizaine d’années et que le maccarthysme a imposé l’idée d’une menace intérieure communiste, Ed Gein révèle un nouveau danger pour l’American Way of Life, celle d’un ennemi monstrueux, sans couleur politique et issu à 100% de la production locale. Et elle continue d’interroger.
Après avoir déjà étudié le sujet dans Deviant, en 1998, l’essayiste et universitaire Harold Schechter replonge au coeur du mal en compagnie d’Eric Powell, le créateur de The Goon, pour une bande dessinée retraçant la biographie d’Ed Gein. Autopsie d’un tueur en série revisite cette incarnation moderne du croquemitaine, de sa naissance à son internement psychiatrique. On y trouve une enfance passée au côté d’une mère tyrannique, bigote jusqu’à la folie. Son interprétation très personnelle des textes sacrés lui font voir le reste de l’humanité, et spécialement les femmes, comme des agents du malin. Dès lors, elle fait tout pour isoler sa famille de toute sociabilité, interdisant même à ses fils de se faire des amis. Le père, en permanence humilié, devient alcoolique et violent avant de mourir d’une crise cardiaque. Seul le grand frère semble garder la tête sur les épaules et se dresse contre sa génitrice… Il est retrouvé mort dans un incendie. Peut-être le premier meurtre d’Ed.
Pourtant, le monstre semble si grotesque, «sociopathiquement» grotesque.
Le roman graphique parvient à faire ressentir l’horreur sans avoir besoin d’en montrer plus que nécessaire, sans embellissement non plus. Le dessin d’Eric Powell, dans un noir et blanc subtil et un réalisme sobre, magnifie le scénario de Schechter, qui met en évidence la construction psychique d’Ed Gein dans un environnement si toxique, mais aussi les conséquences de ces actes pour la communauté et l’imaginaire collectif américains. En effet, la pop culture s’empare rapidement du personnage: à l’époque des faits, Robert Bloch, un écrivain d’une quarantaine d’années habitant à proximité de Plainfield, tente déjà de comprendre les motivations du meurtrier. Il en tire Psychose, un roman qui paraît en 1959 et fait définitivement entrer le «Boucher du Winsconsin» dans le folklore états-unien, puis mondial avec son adaptation sur grand écran par Alfred Hitchcock l’année suivante.
Ce film marque le début d’une série remarquable: les quatre décennies qui suivent l’onde de choc provoquée par l’affaire commencent systématiquement avec l’apparition d’une figure horrifique emblématique du cinéma de genre. Chacun de ces croquemitaines modernes est inspiré directement d’Ed Gein, devenu malgré lui une icône culturelle incontournable et inversée.
Les années 1960 s’annoncent donc avec quelques notes stridentes et glaciales, une scène de douche mémorable et un personnage, Norman Bates, qui n’a pas réussi à régler son oedipe. Le réalisateur britannique impose la figure du tueur en série, qui, avant-guerre, n’avait guère connu que quelques déclinaisons éparses, comme M le Maudit (Fritz Lang, 1931) ou Les Chasses du comte Zaroff (Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, 1932). Il fait de la psychologie un élément central du développement narratif et lancera une «mode» dont se délectera en particulier le giallo italien.
Dix ans plus tard, en 1974, finies les Trente Glorieuses, la guerre du Vietnam s’achève de façon pitoyable pour les Etats-Unis, dont le modèle a été secoué par sa propre jeunesse, et les premiers dégâts de la crise laissent des traces profondes. Tobe Hooper sort l’unes des oeuvres les plus dérangeantes de l’histoire du cinéma, dont la réputation négative et injustifiée en cache toute la dimension sociale: Massacre à la tronçonneuse met en scène la rencontre entre une bande de jeunes post-hippies et une famille cannibale vivant au milieu de débris en putréfaction, et dont le membre le plus imposant, et le plus retardé, porte un masque de peau qui lui donnera son nom (Leatherface). Les ressemblances avec Ed Gein sont évidentes, l’inspiration revendiquée. Comme celle du fou sanguinaire qui ouvre les années 1980, tout aussi malsain, qui montre les années Reagan depuis le caniveau. Dans le Maniac de William Lustig (1980), Frank Zito scalpe des femmes pour recréer sa mère abusive décédée…
En 1991, le monde entre dans une nouvelle ère et redéfinit ses inquiétudes, dont certaines se retrouvent dans Le Silence des agneaux, de Jonathan Demme. Réincarnation du Monstre de Plainfield, le meurtrier Buffalo Bill en reprend l’idée des habits de peau humaine et un rapport immature et problématique à la sexualité. Sans parler d’Hannibal le Cannibale. Le film met surtout en avant le profilage, alors un outil d’investigation relativement récent, destiné à comprendre la psychologie et la logique de ces assassins distinctifs, afin de pouvoir les appréhender.
A travers le cinéma, les séries, la littérature ou la bande dessinée, la représentation des tueurs en série est devenue celle des failles d’un monde en quête d’identité et de sens. Par moments, ils semblent être partout, hérauts maudits des convulsions de la société. Avec Ed Gein comme cinquième cavalier de l’Apocalypse.
■
compte de la «soutenabilité des activités», même s’il existe une fiscalité écologique qui implique que les entreprises doivent payer une taxe sur la pollution qu’elles génèrent ou si ces mêmes industries doivent financer des projets de réduction d’émissions toxiques. «On sait aujourd’hui que ces deux principes offrent aux entreprises les plus polluantes le droit de polluer», observe la spécialiste.
Si le PIB est ringard et trompeur, c’est aussi parce qu’il n’inclut pas le travail gratuit des femmes à domicile, continue Laetitia Vitaud. A ce propos, l’exemple de l’Allemagne, leader européen en matière de croissance économique, est éloquent. A première vue, le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans en Allemagne est supérieur à celui de la France (75% contre 67%). Mais, en réalité, plus de deux tiers des mères allemandes travaillent à temps partiel pour s’occuper de leurs enfants, qui sortent de l’école à la mi-journée et, au final, le temps de travail féminin se révèle à l’avantage de la France. «La productivité allemande n’est-elle pas artificiellement gonflée par le travail gratuit de toutes ces femmes?» questionne l’économiste, sachant que ladite productivité se calcule par la quantité de biens produite divisée par le nombre d’heures utilisées. Un calcul qui ne tient évidemment pas compte du travail gratuit et invisible de ces mercenaires du foyer.
Laetitia Vitaud s’en prend d’ailleurs à un cliché erroné et largement diffusé pour cautionner le fonctionnement machiste de la société. Non, les femmes ne sont pas multitâches! «Comme l’a prouvé une étude de PLOS One en 2019, le cerveau des femmes n’est pas plus efficace que celui des hommes pour gérer deux activités à la fois», rectifie la spécialiste.
Les fameuses charges mentale et émotionnelle entament donc bien la «capacité des femmes à se concentrer et à créer». On s’étonne ensuite que le concept du Grand Créateur soit masculin, ironise la sociologue… L’écrivaine Virginia Woolf a d’ailleurs souligné au début du XXe siècle à quel point disposer d’une chambre à soi et avoir des journées dégagées étaient des conditions terriblement difficiles à obtenir pour une femme.
Mais, au-delà du fossé inégalitaire, l’économiste remet en question le bien-fondé-même de la productivité. Bien sûr, admet-elle, au départ, ce concept était vertueux. Il s’agissait de produire et de gagner plus pour atteindre une prospérité qui rejaillirait sur tous. Les Trente Glorieuses ont d’ailleurs réussi en partie ce pari. Mais la machine s’est emballée et, au lieu d’alléger la charge de travail comme le préconisaient les économistes John Keynes et Jeremy Rifkin, les progrès, industriels puis technologiques ont plutôt intensifié le rythme des journées et surtout «réservé à une petite minorité la jouissance des gains de productivité».
En plus, avec la fin des religions d’Etat et des idéologies, le travail est devenu une valeur sacrée, masculine et patriarcale, qui envoie valser avec mépris toute autre manière d’envisager le monde. N’est-il pas formidablement tendance de clamer «je suis sous l’eau», comme si notre rédemption en dépendait? «N’est-ce pas triste qu’il faille signaler son importance, en se décrivant comme oppressé?» insiste l’économiste qui lève aussi un sourcil dubitatif devant les «greedy jobs», ces emplois voraces dont les adeptes, se moquant des 35 heures, se vantent de «les faire en deux jours»!
A propos de cette obsession de rentabiliser le temps, qu’on appelle aussi l’approche télique du temps, l’autrice cite une anecdote savoureuse et révélatrice des limites de ce fonctionnement. «Un homme d’affaires américain déguste un poisson dans un petit village de la côte mexicaine. Le pêcheur lui raconte qu’il ne pêche que quelques heures par semaine pour passer l’essentiel de son temps à jouer avec ses enfants, prendre le soleil et faire la sieste. Le milliardaire s’en étonne. «Mais vous pourriez rester plus en mer, pêcher plus de poissons, puis acheter d’autres bateaux et, en vingt ans, vous pourriez devenir riche!» Le pêcheur lui demande à quoi cela lui servirait. Le milliardaire répond: «Alors vous pourriez prendre votre retraite, jouer avec vos petits-enfants, prendre le soleil et faire la sieste.»
Sur la base de tous ces constats, Laetitia Vitaud préconise-t-elle dès lors la décroissance, ce ralentissement de la production et de la consommation qui permet à la planète comme aux hommes de souffler? Pas tout à fait, écrit la spécialiste. «J’aime cette idée d’un bien-être décorrélé de la production industrielle, mais, tout d’abord, la société frugale n’est pas forcément un gain pour le féminisme – devinez qui va allaiter les petiots pendant trois ans? Et, par ailleurs, je préfère que l’on valorise les activités de services plutôt qu’une décroissance généralisée.»
L’économiste écoféministe prône donc une «post-croissance» qui met l’accent sur les emplois où les femmes sont dominantes, comme le soin, l’enseignement et tous les services à la personne. Bien sûr, il s’agit aussi d’inverser le paradigme de rentabilité, prévient l’autrice. Si ces activités sont vues par l’Américain William Baumol comme entraînant «une maladie des coûts», c’est parce que, d’une part, elles n’ont jamais été valorisées financièrement et, d’autre part, on a complètement sous-estimé leur contribution effective à l’«économie dure».
On retrouve le paradoxe Adam Smith évoqué au début de l’article. Si, depuis la révolution industrielle, les hommes ont pu s’illustrer dans des métiers à forte valeur ajoutée, c’est grâce aux professions dites féminines ou même aux contributions féminines gratuites qui les ont nourris, soignés, éduqués, réconfortés ou qui ont pris soin de la famille et des proches fragilisés pendant qu’ils travaillaient, avec les excès que l’on sait.
«Les femmes portent la productivité de tous sur les épaules sans en recevoir les fruits. Aujourd’hui, en valorisant les professions où elles sont majoritaires, la productivité humaine – et avec elle la croissance économique – doit davantage se tourner vers notre capacité à entretenir nos liens avec nos semblables, comme avec notre environnement», conclut Laetitia Vitaud. «Tout le monde s’en portera mieux: pas seulement les femmes, mais bien tous les humains.»
■
La Une
fr-ch
2022-08-13T07:00:00.0000000Z
2022-08-13T07:00:00.0000000Z
https://letemps.pressreader.com/article/281930251760461
Le Temps SA