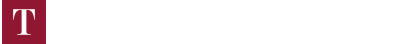Ecrans
«Toutes les histoires que je raconte se sont passées autour de moi.» Rencontre avec Moussa Sène Absa en marge du Festival cinémas d’Afrique, à Lausanne
Elisabeth Stoudmann t @estoudmann
Au téléphone la voix est forte, joyeuse, animée d’une énergie juvénile. Le réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa a pourtant 64 ans. Autodidacte, il a voyagé un peu partout dans le monde et tâté du théâtre, de la peinture, de la musique. Réinstallé à Popenguine, à 75 km de Dakar depuis presque trente ans, il y a tourné la plupart de ses films dont certains sont devenus des classiques. Son style très particulier – entre comédie, chronique de moeurs, conte et cinéma militant – associe de façon inédite tradition et musique. Il en dévoile quelques secrets sans chichis et avec un parler franc.
Vous êtes issu d’une famille de griots, la caste des artistes en Afrique de l’Ouest. Vous considérezvous comme un griot cinématographique?
Le griot a à la fois un rôle social – c’est une courroie de transmission de génération en génération – mais c’est aussi un médiateur. C’est cet aspect qui m’intéresse le plus: interpeller les gens sur des réalités difficiles ou sur des choses dont on parle moins, mais qui pourraient être apaisées en les mettant en avant d’une certaine façon.
Les femmes prennent une place importante dans vos films. On pourrait dire que vous êtes un féministe avant l’heure. Comment expliquez-vous cela?
Je n’ai pas connu mon père. Il est mort quand j’avais 3 jours. J’ai été élevé par ma mère, mes tantes. J’étais tellement proche d’elles qu’elles m’oubliaient. J’étais toujours fourré dans leurs pagnes, j’étais leur petit commis. Elles m’envoyaient faire leurs courses ou porter leur message. Si un homme les demandait en mariage, c’est moi qui allais annoncer la nouvelle à tel autre prétendant qu’elles voulaient éconduire. Mon enfance, tout comme ce rôle que j’ai joué auprès d’elles, a été très importante dans mon approche cinématographique.
Dans deux de vos films présentés à Cinémas d’Afrique, «Tableau Ferraille» et «Madame Brouette», les personnages de femmes sont extrêmement puissants. Madame Brouette est même divorcée. Vous êtes-vous inspiré de situations réelles?
Toutes les histoires que je raconte sont des histoires qui se sont passées autour de moi, dans mon quartier. Madame Brouette, l’héroïne du film, est inspirée d’une amie proche. Cela a toujours été possible de divorcer au Sénégal. A l’époque, ce n’était pas courant, mais possible. Mon amie avait, elle, divorcé trois fois!
Beaucoup de scènes de vos films surprennent et vont à l’encontre des clichés que nous, Européens, pouvons avoir sur l’Afrique de l’Ouest. Par exemple la scène d’ouverture de «Madame Brouette» avec cet homme en robe rouge qui débarque sur la plage au petit matin et se fait tuer.
Un jour, alors que j’étais à Rio, je suis entré sans le savoir dans un bar de travestis. Je me suis retrouvé en un instant dans les bras d’une armoire à glace. Cette image d’un géant noir en robe rouge qui m’enlaçait m’est restée de manière obsessionnelle. Au moment où j’écrivais Madame Brouette, je l’ai associée au personnage de Naago et à la fête du Tajabone, qui est le jour où tout est permis, où hommes et femmes peuvent se travestir. «Ça twiste à Popenguine» est une comédie qui met en scène deux bandes de jeunes dans les années 1960 qui adoptent le look et l’attitude de leurs idoles au point de changer leur nom en Johnny, Sylvie, Eddie, Sheila. L’influence yéyé était-elle réellement aussi importante – et drôle – que ce que vous exposez dans ce film?
C’est un film entièrement autobiographique. Tous les personnages de jeunes existaient réellement et je suis moi-même le personnage du petit Baac. Le bal dont il est question dans le film a réellement eu lieu. On vivait alors une période de sublimation des choses, d’identification. On voulait ressembler à tout sauf à nous-mêmes. Nos chambres étaient recouvertes de posters de Salut les copains. On n’y voyait pas un visage africain. Cette innocence de l’enfance, cet apprentissage des codes m’intéresse.
Vos films sont socialement très critiques. Vous montrez la corruption et une société toujours contrôlée par l’ancienne puissance coloniale.
Je suis un cinéaste engagé. Qu’est-ce qui fait que l’Afrique est le continent le plus riche du monde et le plus appauvri? C’est la question fondamentale. Le Sénégal est dix fois plus riche que la France: nous possédons toutes les ressources. Nous avons la mer. Nous avons une population dont 65% a moins de 30 ans. Mais nous avons un problème de leadership. Tous les dirigeants qui ont essayé d’avoir une réelle indépendance militaire, économique et culturelle, qui ont voulu frapper leur propre monnaie ont été assassinés. Mes films dénoncent ce chaos maîtrisé. Les anciens colons créent le chaos pour venir proposer l’aide, se rendre indispensables. Je pense qu’on ne peut pas être un créateur et voir son pays aller à vau-l’eau sans élever la voix. C’est un devoir. Il faut dire les choses qui peuvent faire avancer la société.
La tradition, la musique sont très présentes dans vos oeuvres. Que représentent-elles?
Je considère la musique comme une ligne narrative. Souvent je fais la musique avant le film. Le film est construit à partir de la musique. Contrairement à ce qui a pu être écrit sur mon cinéma, les groupes de chanteurs ambulants que je mets en scène n’ont rien à voir avec les choeurs des tragédies grecques. Dans toutes les sociétés afri«J’ai été élevé par ma mère et mes tantes. J’étais tellement proche d’elles qu’elles m’oubliaient. Cette proximité avec les femmes a été très importante dans mon approche cinématographique» Moussa Sène Absa caines, il y a eu des troubadours et ce, depuis des millénaires. Ces troubadours allaient de village en village, de saison en saison, en racontant des histoires. Ils étaient hébergés dans les cours royales. Ce sont les premiers conteurs, les ancêtres des griots. Je les utilise comme un lien filmique qui permet de dire l’histoire d’une autre manière, par la tangente. Le chant donne une direction à la narration et apporte de la poésie dans le récit.
Dans vos films, on passe sans transition du wolof au français et du français au wolof. Pourquoi?
Je joue avec l’ambivalence de notre double culture: la culture française héritée de la colonisation et une culture ancestrale qui est là, mais qui n’est pas enseignée dans les écoles, qui n’est pas vulgarisée. Beaucoup de sociétés africaines commencent à perdre leur langue et c’est un vrai problème. Quand j’écoute le wolof à la télé, je vois les mots disparaître. Dans chaque phrase on glisse un ou deux mots de français. Il y a des mots qui se perdent. Notre Constitution est en français, le français est la langue officielle du Sénégal. C’est un frein. Je n’ai encore jamais vu un pays utiliser une autre langue que la sienne et se développer!
Vous faites le trait d’union entre la génération des pionniers du cinéma africain et la nouvelle génération des réalisateurs. Vous avez enseigné et vous continuez à donner des ateliers. Que pensezvous de l’évolution du cinéma africain?
Je dirais que beaucoup de jeunes réalisateurs sont «déformés» au lieu d’être formés. Ils sont obnubilés par les récits importés, au lieu de se concentrer sur l’invention d’un récit. L’Africain, ou du moins le Sénégalais, ne raconte pas les histoires de façon linéaire. Il fait des sauts de puce ou commence par la fin. Un message dit de façon abrupte a moins de chance d’atteindre son objectif qu’un message amené avec intelligence à son auditoire. C’est pourquoi je commence toujours mes films par la fin: c’est plus intrigant! Grosso modo, en France, on ne parle que le français. Alors que chez nous il y a 22 langues, donc 22 cultures et façons de voir le monde, 22 cosmogonies différentes…
Du côté des pionniers du cinéma, lequel d’entre eux vous a le plus marqué?
S’il y a quelqu’un dont le cinéma me parle vraiment, c’est Djibril Diop Mambéty dont j’ai été un temps le premier assistant. C’était un visionnaire, un homme engagé et un artiste à la fois. Il avait une narration unique. Je me rappelle qu’un jour il m’a demandé comment on traduirait le mot cinéma en wolof. Je n’ai pas su quoi lui répondre. Des mois plus tard, il m’a reposé la question. Face à mon silence, il m’a dit: «C’est waru.» En wolof, waru c’est l’étonnement, l’émerveillement, l’inattendu, le sublime, c’est le merveilleux. Dans son film, La Petite Vendeuse de soleil [projeté au Théâtre de Verdure de Montbenon à Lausanne samedi 20, à 21h30], il y a une scène incroyable: une petite fille handicapée qui danse. C’est d’une beauté extraordinaire tout en restant très simple. Personne ne peut être indifférent à cela.
■
La Une
fr-ch
2022-08-13T07:00:00.0000000Z
2022-08-13T07:00:00.0000000Z
https://letemps.pressreader.com/article/281874417185613
Le Temps SA