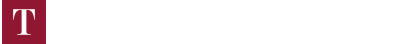Rencontre avec Giona A. Nazzaro, nouveau directeur du Locarno Film Festival
ANTOINE DUPLAN @duplantoine
Italien de Zurich, arpenteur de manifestations cinématographiques aux curiosités multiples, le nouveau directeur artistique du Locarno Film Festival se passionne pour le cinéma de genre. Il promet une édition sachant conjurer la crise sanitaire par la qualité des films et se réjouit de la rétrospective consacrée à Alberto Lattuada
◗
Au cours du deuxième millénaire, le Locarno Film Festival a connu cinq directeurs artistiques. Irene Bignardi, la diva romaine aux yeux de turquoise, Frédéric Maire, le jovial Neuchâtelois parti diriger la Cinémathèque suisse, Olivier Père, le Stéphanois en costume de lin clair devenu directeur d’Arte Cinéma France, Carlo Chatrian, le Turinois barbu parti diriger la Berlinale, et Lili Hinstin, la longue dame brune venue de Paris et envolée après deux éditions seulement, laissant la place à Giona A. Nazzaro, qui a l’élégance, l’humour, la rondeur et l’érudition d’un intellectuel italien, façon Umberto Eco. Il porte une Swatch locarnaise au poignet. La monture noire et les branches jaunes de ses lunettes renvoient aux couleurs du léopard emblématique du festival. C’est un hasard, jure-t-il: sa femme a choisi ce modèle dans la boutique sombre d’un opticien romain sans remarquer la vivacité du jaune.
Né à Zurich en 1965, Giona A. Nazzaro est diplômé en langue et littérature allemande et anglaise – et parle un français remarquable. Il a collaboré avec plusieurs festivals de cinéma italiens, dont le Torino Film Festival, le Festival international de Rome et le Festival dei Popoli de Florence. Délégué général de la Semaine internationale de la critique de la Mostra de Venise depuis 2016 et membre du comité artistique du Festival international du film de Rotterdam, il a été programmateur et membre du comité de sélection de Visions du Réel à Nyon et a participé au Locarno Film Festival en tant que modérateur. Il a travaillé comme programmateur et sélectionneur auprès du Torino Cinema Giovani, du Festival dei Popoli et du Festival international du film de Rome.
Il a écrit et dirigé des ouvrages consacrés aux cinéastes Gus Van Sant, Spike Lee et Abel Ferrara, publié un recueil de nouvelles (A mon
dragone c’e il diavolo). Il est un précurseur des recherches sur le cinéma de Hongkong en Italie. Il a conduit une réflexion sur les nouvelles stratégies narratives des séries télévisées. Passionné par l’influence des nouvelles technologies sur le cinéma et les arts, il est professeur de Media Design and Multimedia Arts à la NABA de Milan. Il est aussi fan de heavy metal – plutôt de trash metal, précise-t-il. Mais cette passion est déjà ancienne: aujourd’hui, c’est le jazz qui lui parle.
Où Giona A. Nazzaro trouve-t-il le temps de faire autant de choses? Il minimise: «Je ne fais que trois choses: je regarde des films, j’écoute de la musique et je lis des livres. Je ne fais pas de sport, je mange très mal, je dors très peu...» Il précise encore: «Je suis quelqu’un de très ennuyeux. Je suis paresseux.» Là, on est libre de ne pas le croire…
Y a-t-il dans votre vie un premier film, une oeuvre qui a déterminé votre cinéphilie?
Pas vraiment. Je sais que c’est une réponse décevante. Mais il y a toujours eu l’idée du cinéma comme autre dimension. Quand j’étais gamin, je passais à côté de ces salles de cinéma des années 1970, avec ces affiches bigger than life, qui sont restées comme l’image par excellence du cinéma! Je me disais que ça devait être génial de voir un de ces films. L’idée du cinéma est aussi liée à une notion d’interdit. Je viens d’un milieu familial très traditionnel. Mon père, ingénieur, était un intellectuel, il faisait partie de la société Lectura Dantis de Zurich, mais la culture était pour lui quelque chose de très traditionnel. Le cinéma n’y était pas vraiment associé – surtout pas dans les années 1970, qui marquent selon moi l’apogée du cinéma de genre. Le cinéma était comme un royaume interdit. Il m’a toujours fasciné.
Vous alliez quand même parfois voir des
films? Dans le village où nous allions en vacances, en Italie, il y avait deux cinémas. J’y allais avec mon cousin, plus âgé que moi mais pas cinéphile. On voyait 50 minutes d’un western italien, puis une comédie un peu désuète. Cette nébuleuse de films dont on entrait et sortait, les spectateurs qui parlaient et fumaient, ce sont mes premiers souvenirs de cinéma. Le tout premier film que j’ai eu envie de voir, c’était Les Dents de
la mer, de Steven Spielberg. Pour mon père, il n’en était pas question. J’ai économisé pour acheter un billet. Le dimanche, mon père, se doutant de quelque chose, m’a emmené à la piscine. A un moment, je me suis cassé de la piscine pour aller au cinéma, provoquant une catastrophe familiale, car ma mère me croyait perdu. Quand je suis rentré le soir, ça a été terrible! Mais voir ce film a été une expérience incroyable. Je pense n’avoir jamais eu aussi peur au cinéma, tout seul, coincé au milieu des gens dans mon fauteuil! Ha ha ha! A l’époque on parlait de Jaws comme d’un film un peu ringard. Plus tard, on l’a rapproché de Moby Dick…
Quelle est la première vertu d’un directeur artistique? La curiosité. Et l’oubli. C’est-à-dire qu’il faut oublier ce qu’il y a eu avant, sinon on essaye de retrouver ce qu’on aime déjà.
Vous reprenez en pleine pandémie la direction artistique d’un festival décapité. Les défis ne vous font pas peur…
Bah… Ayant eu le privilège d’y collaborer, je connais le festival de Locarno depuis très longtemps. Depuis plus de vingt ans, je fais de la programmation pour différents festivals. Donc, sans vouloir donner l’impression d’être arrogant, je n’ai pas peur. Chaque programmateur fait des plans pour diriger un festival. Godard disait qu’il appartenait à la première génération de réalisateurs sachant que David Wark Griffith a existé; nous, nous avons la chance d’appartenir à une génération sachant qu’Enzo Ungari, Roberto Rossellini, Serge Daney, Bernard Eisenschitz ont existé. Nous essayons donc d’être dignes de partager une tradition textuelle, critique ou esthétique. Je dis nous, car je pense à Carlo Chatrian, avec lequel j’ai grandi. Quand nous nous rendions dans un festival, ce n’était pas juste «Ah! J’ai aimé ou pas tel film», nous parlions aussi de la structure du festival. Nous discutions de la programmation, de l’offre, de l’organisation. Un festival, ce n’est pas juste une série de films, mais un discours, une structure, une idée éditoriale. Reprendre le festival de Locarno ne m’a donc pas causé d’angoisse. Le seul souci était: ce virus va-t-il partir? Va-t-on rouvrir la Piazza Grande? Heureusement, Marco Solari a dit qu’on ouvrirait la Piazza coûte que coûte.
Le programme a-t-il été difficile à mettre sur pied à cause de la pandémie?
L’exploitation et la distribution se sont arrêtées dramatiquement; la production, non. On a continué à tourner des films pendant la pandémie, de façon underground mais aussi au plus haut niveau professionnel avec des plateaux où les acteurs, les techniciens étaient régulièrement testés, comme le dernier Mission:
Impossible. Nous n’avons pas souffert d’un manque de films. Au contraire, il y en avait beaucoup. Nous avons très rapidement décidé que nous ne voulions pas d’un buffet à gogo, pas tout présenter pour compenser une année perdue. On a 17 films en compétition. On aurait pu en avoir 25 sans problèmes de baisse de qualité, de compromis ou de mauvais choix. On a décidé qu’il serait plus convaincant d’affirmer la qualité des films aujourd’hui avec un nombre restreint de propositions. Cela dit, 17 films en dix jours, ce n’est pas rien. Sans oublier les autres sections… On a essayé de redessiner la mosaïque du festival sans en changer l’architecture globale. Le festival est un palais magnifique… Pourquoi le changer?
Vous avec confié à «Variety» votre intention de défricher des «territoires non cartographiés». Y en a-t-il encore
et quels sont-ils? Il y en a! Regardez à Cannes! Julia Ducournau signe avec
Titane un film de genre qui, il y a cinq ans, non deux ans, six mois, aurait été considéré comme un film d’exploitation, violent, sadique, bla bla bla… Ayant gagné la Palme d’or, il est maintenant considéré comme une véritable oeuvre d’art. Heureusement, tout le cinéma bouge dans cette direction. Nous présentons des
«Locarno est un festival qui rayonne de façon très forte à partir d’un endroit tout petit»
objets échappant à toute définition, comme Pathos Ethos Logos, de Joaquim Pinto, un film de presque douze heures, expérimental, très personnel, très poétique, qui pose de nombreuses questions sur la foi, la sexualité, la planète, ou aussi De la
planète des humains, de Giovanni Cioni, ou Rampart, un documentaire «no budget» dans lequel, à partir des VHS réalisées par son père, Marko Grba Singh évoque ses souvenirs d’enfance sur le bombardement de Sarajevo. L’idée des territoires à découvrir sous-tend le concept du festival. Il n’est pas nécessaire que la critique, le cinéphile, le public s’en aperçoivent, mais les films parlent entre eux. L’avenir du cinéma, je l’imagine entre les mains de réalisateurs personnels, créatifs, qui ne craignent pas de dialoguer avec l’industrie et sont animés par des idées qui n’appartiennent qu’à eux, qui poursuivent un discours personnel. Sur la Piazza, on projette 100 Minutes, de Gleb Panfilov, qui a gagné le Pardo d’or en 1969 avec Pas de gué dans le
feu, un film d’un classicisme absolument moderniste. Paradoxalement, son dernier film, tiré d’Une Journée
d’Ivan Denissovitch, de Soljenitsyne, relève des uncharted territories, car il contient l’histoire du cinéma russe.
Quelle part de glamour entre dans le
festival de Giona A. Nazzaro? J’adore le glamour. Je ne suis pas un moine. Le cinéma et le glamour sont très fortement liés. Il y a aussi le glamour un peu pervers de ceux qui disent qu’ils ne veulent pas de glamour. C’est le glamour le plus cool… Très difficile à obtenir (rires). Le glamour est un messager du festival. Le président Solari a toujours dit qu’on a «le glamour de l’intelligence». Je partage à fond cette formule. Auprès des stars venues à Locarno, on a découvert des gens qui réfléchissent à leur métier, à leur carrière, qui ont des choses à raconter. On espère continuer dans cette tradition. Bien sûr, le glamour de Jean-Luc Godard, «moi je ne viens pas, mais l’absence c’est le sommet du glamour», est très difficile à obtenir (rire). L’absence très présente de Godard sur la scène des festivals me rappelle le mot d’un poète italien, Giorgio Caproni, selon lequel «Dieu n’existe pas, mais on le voit». C’est un peu la même chose avec Godard.
Qu’est-ce qui différencie Locarno des
autres grands festivals? C’est un festival qui rayonne internationalement de façon très forte à partir d’un endroit tout petit. La qualité de vie des festivaliers est tout à fait différente. A Locarno, on peut voir six films par jour sans renoncer à grignoter quelque chose ou prendre un verre avec des amis, sans subir de files interminables, sans craindre de ne pas trouver de place dans une salle. Il y a la qualité d’un festival de classe A et la qualité de vie que seule la Suisse peut garantir – take it easy, respire, tout va bien se passer… Sans oublier des projections d’excellente qualité. On peut montrer des films en argentique sur la Piazza pour 8000 spectateurs avec les meilleures copies et une qualité de projection irréprochable. Quand j’étais un simple cinéphile, Locarno était un rendez-vous indispensable. On savait que les entretiens qu’on faisait à Locarno avaient une ampleur supérieure à ceux faits dans d’autres festivals car les talents avaient plus de temps.
Craignez-vous qu’au cours des derniers mois le public ait perdu le goût du grand
écran? C’est un risque qu’il ne faut pas se cacher. Malheureusement, on ne retient pas l’exemple de la Mostra de Venise qui, l’an dernier, a prouvé qu’on peut faire sans risque un festival en pleine crise sanitaire. Si je me réjouis que l’Italie ait gagné l’Euro, je trouve bizarre de voir que les 60 000 spectateurs qui regardent un match de foot en pleine pandémie disent qu’ils ne vont pas au cinéma de peur du virus. On travaille à la mise en sécurité du festival depuis la mi-octobre. Une équipe qui ne travaille qu’à ça. C’est extrêmement important que le festival soit vu comme un endroit où l’on peut aller sans crainte.
La rétrospective de votre première édition est consacrée à Alberto Lattuada. Pouvez-vous nous parler de ce cinéaste
italien méconnu? Avec plaisir. Lattuada, c’est un des grands secrets du cinéma italien. Ce qui est bizarre car il a connu un grand succès public de son vivant. Il n’est pas un cinéaste ésotérique, certains de ses films sont presque mythiques. Mais Lattuada n’a jamais joué le jeu de l’auteur identifiable à certaines formes ou figures de style. Il en était conscient. Il disait: «Je pense que seule une rétrospective peut donner l’idée de mon travail.» Un cinéaste français se rapproche de lui: c’est Claude Chabrol. Dans l’oeuvre de Chabrol, on trouve des films extrêmement différents, attestant d’une grande curiosité et d’une grande liberté. Il ne se laisse jamais piéger par la théorie de la politique des auteurs, la rhétorique de la fidélité à certains acteurs ou chefs op. Lattuada, c’était la même chose. Grand expert de littérature russe, architecte, photographe, fondateur de la cinémathèque de Milan, écrivain, ami de l’écrivain Aldo Buzzi, il était un des pères du néoréalisme italien. Ce grand intellectuel pouvait faire des films très maîtrisés comme
I dolci inganni (Les Adolescentes) ou une parodie de film d’espionnage à la James Bond comme Matchless (Mission T.S.). Sa vivacité intellectuelle a déterminé cette vivacité formelle.
C’est dans la discontinuité qu’apparaît
l’oeuvre de Lattuada? Claude Chabrol parlait de ses films comme de briques. «Je ne fais pas une filmographie, je fais un mur, une maison. Pour comprendre ce que va donner la maison, il faut prendre un peu de recul»… Cette image convient à Lattuada. Il tient un discours très précis sur la société italienne. Il a été un des réalisateurs les plus censurés du cinéma italien. Et aussi un cinéaste engagé pour la cause de la modernité sans être forcément lié à un discours politique. Même Antonioni était lié grosso modo au discours du grand Parti communiste italien. Résolument engagé à gauche, Lattuada a toutefois pris du recul. La singularité de cet auteur nous donne des choses à découvrir. Y compris son dernier film, Una spina nel cuore. Un producteur lui a dit que Tinto Brass se faisait plein de fric avec des films érotiques. Mais lui prend des détours et, plutôt qu’un film érotique, il fait un film de fantômes avec une figure de fille qui s’absente et des hommes qui n’arrivent jamais à la saisir. J’ai revu
Bianco, rosso e… (Une bonne planque), avec Sophia Loren, un des très rares films où l’on aborde la question du colonialisme italien en Libye. C’est un cinéaste que j’aime beaucoup.
Locarno Film Festival. Du mercredi 4 au samedi 14 août. www.pardo.ch
La Une
fr-ch
2021-07-31T07:00:00.0000000Z
2021-07-31T07:00:00.0000000Z
https://letemps.pressreader.com/article/281792812067097
Le Temps SA